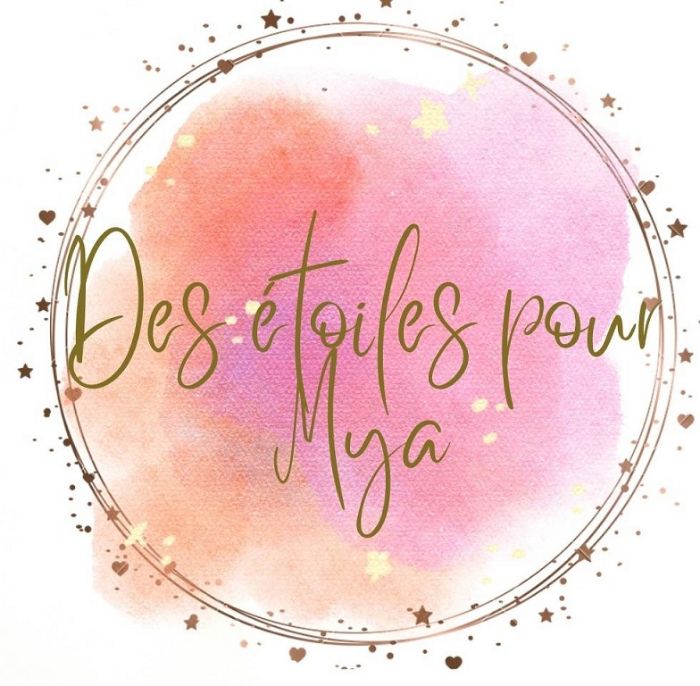L’aplasie médullaire est une maladie rare, dont l’origine est un dysfonctionnement de la moelle osseuse qui rend cette dernière incapable de produire des cellules sanguines (globules rouges, blancs et plaquettes) et donc de remplacer progressivement les cellules circulantes destinées à mourir naturellement.
Dans la moelle osseuse, des cellules dites « souches » présentes en petite quantité, sont responsables de la production des cellules sanguines (globules rouges, blancs et plaquettes). Elles assurent le renouvellement quotidien de ces cellules (environ 100 milliards par jour chez un adulte).
Or dans l’aplasie médullaire, ces cellules souches disparaissent, ne pouvant donc plus assurer leur rôle de renouvellement des cellules sanguines, dont la quantité va donc progressivement diminuer et de façon considérable.
L’aplasie est responsable du déficit d’un ou plusieurs types de cellules sanguines. Les conséquences de l’aplasie sont différentes en fonction du type de cellules déficitaires.
- Les globules rouges sont en charge du transport et de la distribution de l’oxygène dans l’organisme. Lors d’un déficit en globules rouges, l’anémie apparaît.
- Les globules blancs constituent le système de défense de notre corps contre les organismes étrangers (virus, bactérie, champignon,..). Lorsque leur nombre n’est pas suffisant, notre corps se défend moins bien et des infections peuvent apparaître
- Les plaquettes permettent la coagulation du sang et jouent un rôle primordial pour arrêter une hémorragie. Le déficit entraîne des troubles de la coagulation et par conséquent des hémorragies.
En fonction du type de lignées cellulaires atteintes, les conséquences peuvent être multiples.
l'aplasie médullaire est une Maladie rare avec une centaine de nouveaux cas par an.
Quelle est son origine ?
Il s’agit d’une maladie acquise durant l’existence, elle n’est pas contagieuse. L’aplasie médullaire n’est donc pas une maladie héréditaire. Toutefois, si certains gènes peuvent prédisposer à son développement, être porteur de ces gènes ne signifie pas forcément que l’on va développer la maladie. Ces gènes sont ainsi qualifiés de facteurs de susceptibilité, le gène HLADR2 a été identifié comme tel.
Son origine est souvent inconnue, on parle alors d’anémie aplasique idiopathique.
Quels sont les symptômes ?
L’aplasie médullaire peut apparaître brutalement ou alors progressivement et s’installer sans que le patient en ait conscience. En fonction du type de cellules sanguines touchées, les signes sont différents.
Les globules rouges
L’anémie désigne le manque de globules rouges dans le sang, qui entraîne un apport insuffisant en oxygène dans l’organisme. Les signes de cette anémie sont :
- Pâleur de la peau, des muqueuses, de la langue, des gencives et possible conjonctive (membrane qui recouvre le blanc de l’œil)
- Fatigue importante non réversible avec le repos
- Essoufflement, vertiges, palpitations cardiaques à l’effort
- Des douleurs musculaires possibles (sensations de muscles tétanisés)
- Peau terne et sèche, chute des cheveux et diminution de leur brillance et caractère soyeux
- Ongles cassants.
Les globules blancs
Fièvre inexpliquée ou infections à répétition sont le signe d’une diminution des globules blancs, qui, par conséquent, ne peuvent plus assurer la défense de notre organisme. Les infections sont souvent des angines ou des furonculoses (infections de la peau caractérisées par la survenue de boutons purulents, ou furoncle).
Les plaquettes
Lorsque le nombre de plaquettes diminue, des saignements anormaux peuvent apparaître principalement au niveau du nez ou des gencives, ainsi que des bleus fréquents et inexpliqués (hématomes). Des hémorragies au niveau de la peau peuvent également apparaître, appelées purpura (petites taches d’un rouge violacé dont les dimensions varient d’une tête d’épingle à une lentille).
Les traitements de fonds
Il existe à ce jour deux types de traitements de référence pour l’aplasie :
la greffe de moelle osseuse et le traitement par immunosuppresseurs. Le choix du traitement est effectué en fonction des bénéfices et risques de chaque technique pour le patient.
Le traitement par immunosuppresseurs
Il s’agit de médicaments utilisés généralement dans le soin des maladies auto-immunes.
Généralement prescrit en premier, le traitement par immunosuppresseurs peut être efficace, mais les résultats ne sont pas immédiats, un délai de 3 mois avant amélioration est généralement observé.
Le sérum antilymphocytaire (SAL) est le traitement de référence, il est très souvent associé avec de la cyclosporine et/ou des corticoïdes. La cyclosporine est un autre immunosuppresseur, généralement associé au SAL lorsque celui-ci n’est pas assez efficace.
La greffe de moelle osseuse
La greffe est le seul traitement réellement curatif. Il s’agit de remplacer la moelle osseuse du patient par celle d’un donneur compatible, qui fabriquera des cellules sanguines normales (globules rouges, blancs et plaquettes).
Elle est généralement proposée en premier choix chez des patients jeunes (moins de 40-50 ans) ayant une forme très sévère de la maladie, ainsi qu’un donneur apparenté compatible. Il s’agit le plus souvent d’un frère ou d’une sœur car le taux de compatibilité est le plus élevé, 1 sur 4.
En l’absence de donneur apparenté, la greffe n’est indiquée qu’en deuxième choix, une recherche est alors effectuée dans le fichier national ou international de donneurs.
Ce traitement lourd peut entraîner des complications graves, mais la guérison est obtenue dans 70 à 80 % des cas après 5 ans.
Une autre technique, la greffe de sang de cordon ombilical peut également être proposée surtout chez les enfants.
Après la greffe…
Lorsqu’une greffe a été réalisée, le patient n’a pas encore récupéré un système immunitaire efficace et doit séjourner pendant plusieurs semaines en chambre stérile afin de limiter le risque d’infection.
Il est placé sous surveillance et notamment pour des risques hémorragiques, infectieux et anémiques.
La principale complication est la possibilité de rejet de greffe (10 % des cas), le système immunitaire du patient n’accepte pas les cellules de la greffe et les détruit. Celui-ci peut survenir rapidement ou dans les 2 à 3 années suivantes. Pour essayer de pallier ce problème, un traitement par immunosuppresseurs est prescrit (globulines anti-thymocytes, cyclosporine et cyclophosphamide).
Dans certains cas, les cellules greffées peuvent se retourner contre l’organisme du patient car il s’agit de cellules immunitaires qui ne reconnaissent pas les cellules du patient et veulent les détruire. On parle de réaction du greffon contre l’hôte, qui ne survient qu’en cas d’incompatibilité entre le donneur et le malade ou quand le patient a un système immunitaire très affaibli.
Traitements de support
Ces traitements permettent de prévenir ou de traiter les risques de l’aplasie :
- Risques liés à l’anémie : transfusion de culots de globules rouges pour maintenir le taux d’hémoglobine au-dessus de 8 g/l
- Risque hémorragique : transfusion de plaquettes pour maintenir un taux supérieur à 10-20000.
- Risques d’infection : tout épisode de fièvre, quand les polynucléaires neutrophiles sont < à 500, est une urgence thérapeutique nécessitant une couverture antibiotique.
Les facteurs de croissance permettent dans certains cas de stimuler le renouvellement et le développement des cellules sanguines.
Pour les globules rouges, différents types d’érythropoïétines peuvent être prescrits. Pour les globules blancs, il s’agit de protéines actives sur les granulocytes : G-CSF, GM-CSF.
Le suivi
Le suivi de l’aplasie médullaire est effectué en milieu hospitalier en consultation d’hématologie et d’immuno-hématologie spécialisée.
Les unités de greffe de moelle assurent le suivi des personnes greffées.
source: hpnfrance.com